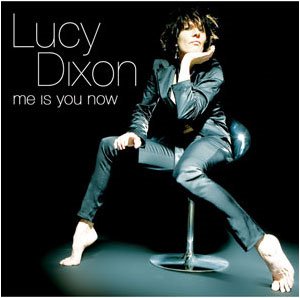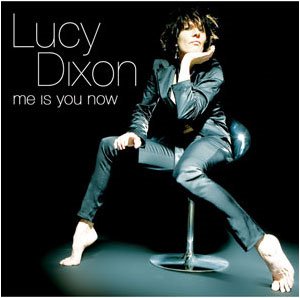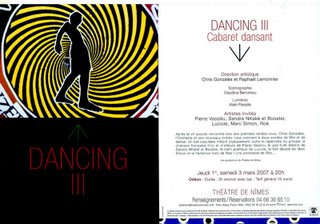LE NOUVEAU PROTOCOLE SERA(IT) APPLICABLE DES LE 31 MARS 2007 !!
-SUPPRESSION DE L’AFT : 42000 (Ré)OUVERTURES DE DROITS EN MOINS
-DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCES
-BAISSE DES ALLOCATIONS
NON A L’AGRÉMENT DU PROTOCOLE D’ASSURANCE CHÔMAGE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE !
Vendredi 2 mars, la rédaction du protocole dit du 18 avril a été finalisée au MEDEF.
Il est désormais prêt à être agréé par le gouvernement
CE QUI NOUS ATTEND : LE PROTOCOLE DU 18 AVRIL 2006
Ce protocole conforte et aggrave celui du 26 juin 2003, dénoncé inlassablement depuis plus de trois ans.
La réforme mettra en place toute une gamme de menaces, de contrôles et accentuera ainsi la nouvelle insécurité sociale qui conduit à la course aux heures et aux cachets et à l’acceptation de n’importe quel emploi.
Il fragilise les plus précaires.
Il n’incite nullement à la juste déclaration des heures travaillées.
Il exclut la prise en compte des congés maladie et des heures de formation.
Il interdit à nouveau le cumul avec des heures hors annexes et multiplie ainsi les obstacles à l’entrée de nos professions.
Il divise, sectorise et fait régner au nom d’une moralisation méprisante, un contrôle administratif incompétent et tatillon de nos parcours professionnels.
Et ceux qui avec le protocole de 2003 touchaient de grasses indemnités vont les voir diminuer sévèrement.
CE QU’ON ENTERRE : L’AFT (ALLOCATION FONDS TRANSITOIRE) ADIEU LES 507 HEURES EN 12 MOIS !
Le protocole du 18 avril signe la fin de l’AFT, acquise par la lutte, qui a permis 42 000 (ré)ouvertures de droits.
CE QU’ON NOUS PROMET : BAISSE DE L’ALLOCATION, RECONVERSION OU RMI
Pour ceux qui ne réunissent pas 507h en 10 mois ou 10 mois et 1/2, le gouvernement annonce la création d’un « Fonds de professionnalisation » qui est une allocation de fin de droits (de type ASS) d’une durée de 2 à 6 mois suivant l’ancienneté dans le régime de l’intermittence, et qui n’est en aucun cas une possibilité de réouverture de droits. La gestion de ce fonds sera confiée à une caisse à part, et l’accès à ce fonds est assorti d’exigences de reconversion. Ou bien simple fonds transitoire vers le RMI.
Dans un contexte général d’exclusion de toute indemnisation chômage d’une part toujours plus grande de la population, la politique de dégraissage du « secteur culturel » continue. Cette politique repose sur une subordination de plus en plus grande des artistes et techniciens aux industries culturelles et aux institutions.
ILS ONT SIGNE, NOUS PERSISTONS !
Nous persistons parce que
c’est la lutte menée ensemble, coordinations et syndicats, depuis 2003 qui a freiné les effets les plus dévastateurs du protocole du 26 juin 2003, avec la création puis le prolongement de l’AFT, la prise en compte des jours de maladie et de congé maternité…
les signataires de l’Unedic ne nous représentent en rien et méprisent nos fragiles réalités,
nos pratiques culturelles concernent l’état du sensible dans la société, la place de la critique, de l’éthique, de la vie dans des arrières pays et zones urbaines que nous contribuons à requalifier, revivifier.
cette réforme est au cœur de la politique qui vise à rendre les chômeurs responsables de leurs situations pour mieux développer la concurrence entre salariés. La précarisation de tous les salariés impose de supprimer un régime qui concède des garanties collectives à l’emploi discontinu et qui est une alternative à la « société des individus » qu’ils appellent de leur vœux.
nous nous savons producteurs de richesses économiques sociales et morales, sensibles.
NON A L’AGRÉMENT DU PROTOCOLE 2006 !
MANIFESTATION
LUNDI 12 MARS
Départ à 17h devant le cirque d’hiver (M° Filles du Calvaire) pour se rendre à l’Olympia
Nous sommes nombreux et en avons assez d'être plaints !
La tribune de Pascale Ferran lors de la “cérémonie” des césars 2007 :
Violence économique et cinéma français, par Pascale Ferran
Nous sommes nombreux dans cette salle à être comédiens, techniciens ou réalisateurs de cinéma. C'est l'alliance de nos forces, de nos talents et de nos singularités qui fabrique chaque film que produit le cinéma français.
Par ailleurs, nous avons un statut commun : nous sommes intermittents du spectacle. Certains d'entre nous sont indemnisés, d'autres non ; soit parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment d'heures, soit, à l'inverse, parce que leurs salaires sont trop élevés pour être indemnisés dans les périodes non travaillées.
C'est un statut unique au monde. Pendant longtemps, il était remarquable parce qu'il réussissait, tout en prenant en compte la spécificité de nos métiers, à atténuer un peu, un tout petit peu, la très grande disparité de revenus dans les milieux artistiques. C'était alors un système mutualisé. Il produisait une forme très concrète de solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication d'un film, et aussi entre les générations.
Depuis des années, le Medef s'acharne à mettre à mal ce statut, en s'attaquant par tous les moyens possibles à la philosophie qui a présidé à sa fondation. Aujourd'hui, il y est presque arrivé. De réformes en nouveau protocole, il est arrivé à transformer un système mutualisé en système capitalisé. Et cela change tout. Cela veut dire, par exemple, que le montant des indemnités n'est plus calculé sur la base de la fonction de son bénéficiaire mais exclusivement sur le montant de son salaire. Et plus ce salaire est haut, plus haut sera le montant de ses indemnités.
Et on en arrive à une absurdité complète du système où, sous couvert de résorber un déficit, on exclut les plus pauvres pour mieux indemniser les plus riches.
Or, au même moment exactement, à un autre bout de la chaîne de fabrication des films, d'autres causes produisent les mêmes effets. Je veux parler du système de financement des films qui aboutit d'un côté à des films de plus en plus riches et de l'autre à des films extrêmement pauvres.
Cette fracture est récente dans l'histoire du cinéma français.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce qu'on appelait les films du milieu - justement parce qu'ils n'étaient ni très riches ni très pauvres - étaient même une sorte de marque de fabrique de ce que le cinéma français produisait de meilleur.
Leurs auteurs - de Renoir à François Truffaut, de Jacques Becker à Alain Resnais - avaient la plus haute opinion des spectateurs à qui ils s'adressaient et la plus grande ambition pour l'art cinématographique. Ils avaient aussi, bon an mal an, les moyens financiers de leurs ambitions.
Or ce sont ces films-là que le système de financement actuel, et en premier lieu les chaînes de télévision, s'emploie très méthodiquement à faire disparaître.
En assimilant les films à vocation artistique aux films pauvres et les films de divertissement aux films riches, en cloisonnant les deux catégories, en rendant quasi impossible pour un cinéaste d'aujourd'hui le passage d'une catégorie à une autre, le système actuel trahit l'héritage des plus grands cinéastes français.
Et leur volonté acharnée de ne jamais dissocier création cinématographique, point de vue personnel et adresse au plus grand nombre. Ce faisant, il défait, maille après maille, le goût des spectateurs ; alors même que, pendant des décennies, le public français était considéré comme le plus curieux, le plus exigeant, le plus cinéphile du monde.
Ici comme ailleurs, la violence économique commence par tirer vers le bas le goût du public puis cherche à nous opposer. Elle n'est pas loin d'y arriver.
Les deux systèmes de solidarité - entre les films eux-mêmes et entre ceux qui les font -, ces deux systèmes qui faisaient tenir ensemble le cinéma français sont au bord de la rupture.
Alors peut-être est-il temps de nous réveiller.
Peut-être est-il temps de nous dire que notre amour individuel pour le cinéma, aussi puissant soit-il, n'y suffira pas.
Peut-être est-il temps de se battre, très méthodiquement nous aussi, pour refonder des systèmes de solidarité mis à mal et restaurer les conditions de production et de distribution de films qui, tout en donnant à voir la complexité du monde, allient ambition artistique et plaisir du spectacle.
Nous n'y arriverons pas, bien sûr, sans une forme de volonté politique d'où qu'elle vienne. Or, sur de tels sujets, force nous est de constater que celle-ci est désespérément muette. Mais rassurons-nous. Il reste 55 jours aux candidats à l'élection présidentielle pour oser prononcer le mot "culture".
Pascale Ferran, cinéaste, a lu ce texte lors de la cérémonie des Césars 2007, samedi soir 25 février à Paris, après que son film adapté du roman de D.H. Lawrence a été couronné de cinq Césars.